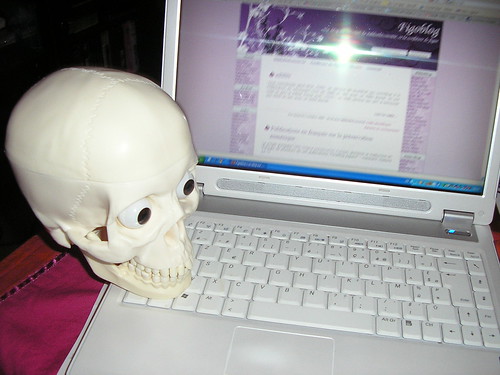J’ai eu souvent affaire à cette question ces derniers temps, que ce soit dans le contexte de l’association Europeana, d’IIPC ou encore des projets collaboratifs de la BnF : comment faire cohabiter harmonieusement les modes de fonctionnement radicalement différents d’une institution et d’une communauté ?
Les institutions ont plusieurs atouts dans leur manche. Elles sont organisées, pérennes et souvent dotées de ressources telles que des moyens financiers ou logistiques. Wikipédia ne pourrait pas exister s’il n’y avait pas quelqu’un qui faisait tourner les serveurs et lançait les campagnes annuelles de collecte de dons. Bien sûr, Wikipédia n’existerait pas non plus s’il n’y avait la communauté pour créer, organiser, surveiller et améliorer les contenus. Le succès de l’entreprise repose sur la bonne entente des deux colocataires, qui se répartissent harmonieusement les tâches ménagères (les anglo-saxons utilisent d’ailleurs le terme de « housekeeping » pour désigner les affaires administratives). Pourtant la lourdeur des institutions, avec les règles parfois rigides dont elles sont obligées de se doter pour fonctionner, peut avoir pour conséquence un désintérêt, une désaffection voire franchement une défiance de la part des communautés.
Face à ce problème, on peut avoir rapidement l’impression d’essayer de réconcilier deux colocataires qui doivent vivre dans le même appartement alors que l’un est maniaque et psychorigide et l’autre joyeux et bordélique. Au départ, sur le papier, on a l’impression qu’ils sont faits pour s’entendre : l’un des deux apportera la bonne ambiance, les fêtes et la bonne bouffe, l’autre se chargera du ménage le lendemain et de la bonne tenue du foyer. Sauf que rapidement la colocation vire au cauchemar, chacun ayant l’impression de donner plus qu’il ne retire de bénéfices dans l’opération.
De façon assez intéressante, j’ai dernièrement eu l’occasion de regarder le problème sous les deux angles, à travers mon expérience dans Europeana et dans IIPC.
Côté Europeana, on observe un équilibre (ou une tension, ce qui revient au même) intéressant entre l’institution, représentée par la Fondation qui met en œuvre le portail Europeana Collections, et l’Association, qui est censée représenter les intérêts de la communauté. Lequel des deux est le plus important ? Qu’est-ce qui apporte plus de valeur au citoyen européen, entre un portail donnant accès à cinquante millions de ressources numérisées et une plateforme destinée à dynamiser un réseau de professionnels ? Le produit ou la communauté ? J’ai déjà donné mon avis sur la question…
Côté IIPC, le consortium qui a atteint l’âge vénérable de 12 ans doit aujourd’hui passer d’un modèle institutionnel (consistant à définir des projets puis les financer et les piloter) à un modèle de communauté où les projets émergent d’eux-mêmes et pour lesquels il agit comme un facilitateur. Ce changement de logique est compliqué à opérer, mais essentiel pour sa survie et sa croissance.
Enfin, ma récente visite à la British Library, avec la présentation des communautés qu’ils animent comme le Knowledge Quarter ou le Digital scholarship avec son Labs, m’a permis de mieux comprendre les différences entre la logique institutionnelle, qui repose sur la mise en œuvre de projets ou de produits, et celle qui anime les communautés. Il s’agit vraiment de deux façons complètement différentes d’aborder un sujet ; elles ne sont pas forcément incompatibles mais reposent à plusieurs égards sur des logiques opposées.
Le point de départ : think big
La communauté se caractérise par un concept de départ autour duquel il y a une compréhension partagée du problème qu’on cherche à résoudre. Des concepts comme « open innovation », « digital scholarship » ou « knowledge quarter » en sont de bons exemples. Une fois qu’on a réussi à mettre tout le monde d’accord sur le mot à utiliser qui va guider la communauté et faire converger les énergies, le reste suit.
Côté projet, on ne part pas d’un concept mais d’un programme, d’un résultat attendu ou livrable. On définit ce qu’on veut construire, puis on met en place le programme qui permet d’y arriver. Les dix minutes passées à choisir un acronyme imbitable qui deviendra la marque du projet pour le meilleur et pour le pire sont rarement une priorité.
Le « programme » qui sert de point de départ au projet est orienté résultat, alors que le concept qui permet de fonder la communauté est centré sur une compréhension partagée du problème (indépendamment des solutions qu’on peut lui apporter).
Les ressources : fund raising vs. call for proposals
Communautés et projets recourent à des méthodes très différentes pour réunir du financement.
Parce qu’elles reposent sur des concepts partagés et puissants, les communautés ont la capacité d’inciter leurs contributeurs à contribuer à la hauteur des moyens dont ils disposent (ou qu’ils souhaitent apporter), qu’il s’agisse d’argent, de moyens en nature (lieux, fournitures, etc.) ou de compétences. Les moyens apportés peuvent être très petits mais innombrables (cas de Wikipédia aussi bien dans la levée de fonds – crowdfunding – que dans la production de contenus – crowdsourcing) ou ponctuels mais énormes (cas du mécénat apporté par de grosses fondations ou entreprises américaines). Ils sont dans tous les cas difficilement prévisibles à l’avance et obligent la communauté à adapter ses actions aux moyens disponibles, en croissance aussi bien qu’en décroissance suivant la conjoncture.
Côté institutions et projets, le modèle qui prévaut est la subvention : on commence par évaluer combien coûte ce qu’on veut fabriquer, on se partage le gâteau entre partenaires en fonction de l’effort que chacun peut mettre et on va voir un tiers pour obtenir la somme. Ce tiers peut être un pouvoir public (tutelle, agence comme l’ANR…) mais ce modèle est aussi très souvent utilisé par les institutions dans leur recherche de mécénat.
Les méthodes de travail : start small, fail often
Cette différence dans la manière de financer leurs activités a bien sûr un impact sur ce que communautés et projets sont capables de produire et la méthode employée pour ce faire. Là où le projet s’impose dès le départ un résultat à atteindre et un calendrier, la communauté préfère lancer une multitude de petits projets, dont certains échoueront, mais ce n’est pas grave. On est dans la logique de l’essai-erreur, le principe étant de concrétiser aussi vite que possible les idées pour pouvoir se débarrasser rapidement de ce qui ne fonctionne pas et laisser grossir les « best-sellers », presque naturellement emportés par leur succès.
Les dépenses : hacking & yacking
De façon tout à fait logique, les communautés ne dépensent pas non plus leur argent de la même manière que les institutions. Se vivant comme des facilitateurs, elles vont consacrer une part significative de leurs ressources à permettre aux êtres humains qui constituent les communautés de travailler ensemble. Et que font les êtres humains ? Ils mangent, boivent, se rencontrent et communiquent. Rien d’étonnant, donc, que dans une communauté les dépenses soient souvent orientées vers des frais de déplacement, de bouche, de communication ou de logistique. Et s’il y a des emplois à financer, ils seront le plus souvent tournés vers ce type d’activité (planification d’événements, etc.). Le reste, la ressource qui produit réellement du travail, est en fait apportée par la communauté. L’exemple typique c’est le hackathon : l’institution ou l’organisateur fournit un lieu sympa, du café à volonté et des pizzas (yacking), la communauté fournit des idées, de la force de travail et des compétences (hacking).
Vu depuis une logique de projet, l’équilibre financier d’une communauté est une aberration. Un projet va en général consacrer 10 à 20% de son budget à sa propre gestion et communication. Le reste sert à financier des emplois, des équipements, du matériel, bref à acquérir ce que la communauté génère par synergie mais sans garantie de résultat. Si on veut des résultats garantis, il faut aussi garantir les moyens. Cela semble logique, en tout cas vu depuis l’institution…
La mesure du succès : empower & engage
La communauté se considère comme un facilitateur : son objectif principal est d’impliquer (to engage) ses membres et de leur donner des moyens (to empower) pour créer les conditions de la concrétisation de leurs propres idées. L’institution, elle, s’approprie les résultats du projet ou le produit, pas forcément au sens de la propriété intellectuelle mais au moins en tant qu’autorité productrice de ces résultats, généralement mesurables au moyen d’indicateurs. L’approche projet donne donc en apparence un retour sur investissement plus concret. Le résultat est un produit visible, tangible, dont l’institution peut revendiquer la paternité. Pour autant, ce produit sera-t-il suffisamment évolutif, maintenable, et tout simplement réussi ? La communauté de ses utilisateurs sera finalement seul juge.
Quand on cherche à mesurer les résultats de la communauté, on peut avoir l’impression d’une situation contrastée, entre quelques grandes réussites fulgurantes d’une part et une multitude d’initiatives dispersées et pas forcément très pérennes d’autre part. De plus, il n’est pas toujours évident de mesurer la part que la communauté a joué dans le succès d’un projet né en son sein.
Au final, les communautés et les projets ont des moyens très différents de mesurer leur succès. L’objectif premier du projet est de réussir, c’est à dire de livrer des résultats qui correspondent à ce qui était annoncé au départ. Les communautés, elles, cherchent à grossir, à engager de plus en plus de gens, sans poser de limites ou d’objectifs.
Finalement, les communautés sont-elles utiles ?
Si vous vous posez cette question, c’est que vous n’avez probablement pas (encore) intégré le mode de pensée qui sous-tend les communautés. Les communautés sont comme les fées : elles n’existent que par et pour ceux qui y croient. Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il suffit de taper dans ses mains, mais l’idée est là : parce que leur but premier est de réunir des gens qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes buts et sont prêts à y consacrer des ressources (du temps, des moyens, de l’énergie), les communautés n’ont pas besoin de prouver leur utilité pour exister. Le seul fait qu’elles existent crée de la valeur, une valeur parfois difficilement mesurable et observable de l’extérieur mais clairement ressentie par ses membres, qui perçoivent l’apport de la communauté à leur réussite, même si cet apport est difficile à quantifier ou à retracer de manière directe. Cette valeur se réalise parfois de façon concrète dans des ressources partagées qu’on appelle les communs.
Dans leur livre L’âge de la multitude, N. Colin et H. Verdier qualifient la multitude (ce que j’ai appelé ici les communautés, car à mon avis la multitude n’est pas une réalité unique mais plurielle) d’ « externalité positive » : quelque chose qui est en dehors du projet ou du produit, mais contribue à créer de la valeur qui joue en faveur de sa réussite de manière plus ou moins mesurable. Pour eux, le principal enjeu de la transition numérique, pour les organisations, institutions ou entreprises, est d’entrer en synergie avec la multitude. Pour cela, les institutions doivent devenir des plateformes principalement dédiées à permettre à la multitude de s’en emparer et ainsi déployer sa créativité.
Ce modèle qui a fait le succès des Uber, Amazon, Facebook et autres Twitter implique, pour des institutions comme les bibliothèques, de lâcher prise sur un certain nombre choses : les projets et les produits, les indicateurs de performance, la propriété de ce qu’elles créent. Il suppose de se définir comme une plateforme et donc se recentrer sur le service qu’on offre aux communautés, leur permettant d’exprimer leur créativité ; de se poser en facilitateur d’une expérience plutôt qu’en fournisseur d’un produit (en l’occurrence la collection) ; de concevoir ses propres objectifs en mineure et ceux de ses usagers en majeure. C’est ce que les bibliothèques ont commencé à faire avec la notion de « troisième lieu ».
Parce que toute réflexion de fond sur les bibliothèques ramène toujours à cet ouvrage indispensable qu’est La sagesse du bibliothécaire, je vais conclure en reprenant la citation de Michel Melot retenue par Mathilde Servet dans son article : « Pour atteindre son seuil critique, il faut que la bibliothèque ait de nombreux lecteurs et bien d’autres usages que la simple lecture. La bibliothèque n’existe que par la communauté […] [Le bibliothécaire] ne parle pas pour lui-même mais pour la communauté qu’il sert. Il doit en refléter les goûts et les opinions, mais aussi les ouvrir à d’autres. Son choix doit être celui de la pluralité […], cette “bigarrure” qui caractérise les sociétés libres. »